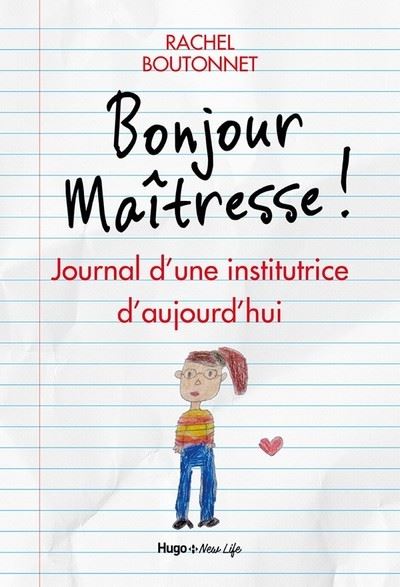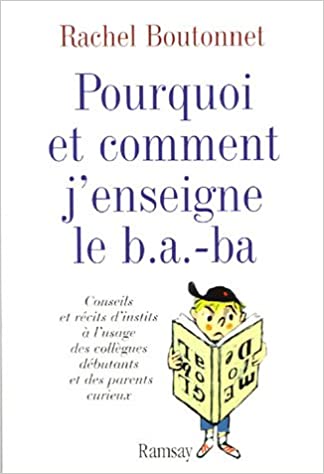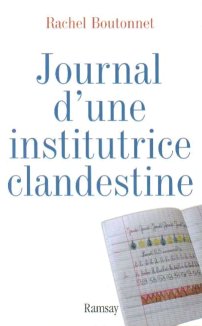Enfance et scolarité
J’ai grandi dans les années soixante-dix, dans le milieu dit « gauchiste » post soixante-huitard, à Montpellier.
Mère médecin généraliste versée dans la psychanalyse, père ingénieur agronome à l’INRA, intéressé par le développement du Tiers-Monde.
Dans la famille, un certain nombre de médecins, de psys et de profs.
Mes grands-parents paternels, en particulier, avaient été professeurs en Ecole Normale d’Instituteurs. Ils avaient connu l’ascension sociale que pouvait offrir l’école des années 1920 : repérés par leur instit dans leur école de campagne, certificat d’étude, entrée à l’Ecole Normale à quinze ans, formés trois ans, diplômés instits à dix-huit ans, quelques années d’enseignement, puis concours, pour terminer, elle, professeur de mathématiques, lui, professeur de physique. Ils avaient connu deux guerres, ils étaient pacifistes, favorables au Front populaire, engagés dans le mouvement des Auberges de Jeunesse, et plus tard, ils ont apporté leur soutien au mouvement des objecteurs de conscience.
Mes parents, eux, ont toujours voté à gauche, et pour autant que je sache, socialiste. Quand nous étions enfants, ma sœur et moi, ils nous emmenaient dans des manifs ou dans les grands rassemblements du Larzac.
Nous sommes allées à l’école publique du quartier, à La Paillade, qui rassemblaient des enfants de petits bourgeois, comme moi, des enfants de familles ouvrières, des enfants d’immigrés algériens, de familles gitanes, de familles pieds-noirs… L’ambiance était parfois agitée, il arrivait aux maîtres de se fâcher très fort, mais rien qui pouvait effrayer un enfant de six ans ou dix ans. Pour moi, tout allait bien.
J’adorais l’école. J’aimais l’air du matin quand je sortais de la maison pour m’y rendre à pied, avec ma sœur. J’aimais l’odeur des couloirs, des salles, des livres, des cahiers. J’aimais la paix de la classe.
J’ai commencé à lire, à un rythme soutenu, à partir du CP. Ma grand-mère paternelle alimentait régulièrement ma bibliothèque. Je trouvais aussi un grand choix de livres dans la maison de vacances de mon grand-père maternel : des romans pour enfants, des livres jaunis, dont j’adorais l’odeur de vieux papier. La lecture s’est installée dans ma vie pour toujours. Puis l’écrivain, comme figure idéale.
Mars 1981 : élection de François Mitterrand à la présidence de la République. Explosion de joie, champagne, les voisins en liesse et des mois d’euphorie, dans l’entourage de mes parents.
Alors que j’étais au milieu de mon CM1, en mars 1982, nous sommes partis pour deux ans au Mozambique, qui avait accédé à l’indépendance en 1975. Mon père s’y rendait en tant que coopérant, employé au ministère de l’agriculture. Nous habitions Maputo, la capitale, dans un petit appartement d’un immeuble de deux étages. Ma mère occupait un poste de médecin à l’hôpital psychiatrique, employée du gouvernement mozambicain.
Maputo… les jacarandas, les bougainvilliers, les flamboyants, la terre rouge des trottoirs. Les mangues, les goyaves, les papayes et les mandarines, la farine de maïs et le poisson préparés quotidiennement, les parties de corde à sauter endiablées des petites filles dans la rue, les femmes et leur enfant dans le dos, la façon experte et gracieuse d’installer l’enfant et de nouer le tissu, la grâce de la démarche, bébé tendrement endormi contre sa mère portant un grand paquet sur la tête. L’accent chantant du portugais mâtiné de shangane, les longues marches à pied dans la ville, avec ma sœur, pour rendre visite à des amis, le salut joyeux des femmes : « Olà, meninas ! », quand elles voyaient passer les enfants blondes que nous étions ; le monde entier réuni, par le biais des coopérants ou des réfugiés politiques : l’Amérique Latine, l’Europe du Nord… La lumière radieuse, l’air léger, la plage au bord de la ville. Les discours interminables du président, quelques mesures contre la liberté d’expression, les contrôles militaires lors des déplacements hors de la ville, l’Afrique du Sud voisine encore sous apartheid, les magasins souvent vides, les coupures d’eau régulières, les longues files d’attente pour toute démarche administrative, les inondations d’après cyclone, suivies de sécheresses, la guerre civile qui commence au Nord et descend vers Maputo, lentement et sûrement, les routes devenues dangereuses… La guerre était aux portes de la ville, quand nous sommes partis. Je n’ai jamais senti la guerre. Juste la paix magique de cette ville magnifique, avec ses grands jardins fleuris aux vues sur l’Océan Indien.
Retour en France en décembre 1984.
Ces années-là, politiquement, c’était avant tout la montée inquiétante du Front National.
Première percée spectaculaire en 1986, lors des législatives.
A Montpellier, au collège, j’entendais régulièrement des discours violemment racistes, de la part de certains enfants, souvent de famille pieds-noirs. J’avais parfois des discussions houleuses avec des camarades qui affirmaient : « Tu diras ce que tu diras, les Arabes, il y en a trop. » A la caisse d’un supermarché, une jolie caissière, qui dit tranquillement : « Ma fille n’aura pas d’enfants tant que ce pays ne sera pas nettoyé ». Tant de propos de ce type. A vous nouer la gorge pour toujours.
1987 : Le procès Barbie. Je l’ai suivi avec passion. J’ai lu des livres sur la Shoah, dont le magistral, incroyable, Dernier des Justes, d’André Schwart-Bart.
1988 : Arrivée en banlieue Parisienne. Les luttes contre le Front National se poursuivaient. « Touche pas à mon pote », « SOS racisme », « Fêtes de toutes les couleurs » à la Courneuve… Mes amis et moi étions de tous les rassemblements.
1991 : Fac en philo, à Nanterre. Je traversais une période sombre. J’étais une étudiante moyenne. Mais j’ai réussi à mener quelques lectures et suivre des cours magnifiques, qui m’ont laissé, par bribes précieuses, des marques définitives. Ce sont les écrits politiques qui m’intéressaient le plus : Kant, Condorcet Rousseau… et surtout Spinoza, dont je n’ai jamais lu l’Ethique en entier, mais plusieurs fois les écrits politiques et les lettres.
1997 : Maitrise, sous la direction d’Etienne Balibar : Spinoza et la tolérance.
A bonne école
Je suis venue à bout de la rédaction de ma maîtrise grâce au soutien bienveillant du compagnon de ma mère - père de mon petit frère -, Christian Geffray, détenteur d’une maîtrise de philosophie, puis d’un doctorat en sociologie, qui lui avait valu d’être nommé dès la fin de sa soutenance à l’Orstom – IRD-, dans le département d’ethnologie, en 1987.
Il s’est intéressé à mon sujet, en a longuement discuté avec moi, particulièrement quand je me trouvais bloquée dans l’avancement de mon texte, me permettant chaque fois de résoudre mes difficultés. Il m’a même accompagnée au magasin de reprographie pour faire imprimer et relier mon texte, concluant les quelques semaines de travail en sa compagnie par un tranquille : « C’était bien ».
Ma mère, séparée de mon père depuis 1983, l’avait rencontré au Mozambique, où il travaillait pour sa thèse, une étude de la société Makhuwa, dont il a tiré son premier livre : Ni père ni mère, publié en 1990.
Son deuxième livre, La Cause des armes, paru lui aussi en 1990, porte sur la guerre au Mozambique. Ce qui m’a frappée dans ce beau texte, c’est son immense considération pour ses interlocuteurs. Des gens montrés dans leur dignité et leur courage, comme cette femme réfugiée, qui venait de traverser les lignes ennemies à pied avec ses enfants, qu’on s’attend à voir décrite comme épuisée et inquiète, et dont il souligne avant tout le sourire radieux.
Il a travaillé ensuite six années au Brésil, enquêtant sur les récolteurs de caoutchouc, les trafiquants de drogue, les Indiens Yanomami. Il en a tiré deux autres livres : Chroniques de la servitude en Amazonie brésilienne : essai sur l'exploitation paternaliste, paru en 1995, Le Nom du Maître : contribution à l'anthropologie analytique, publié en 1997.
Tous les terrains qu’il a étudiés étaient violents. Je me demande si la grande affaire de sa vie, ce n’était pas de comprendre la violence, de ne pas se laisser vaincre par elle, en la canalisant, filtrant, transformant par l’écriture. Autre affaire primordiale : rester confiant. « Le courage, ça existe, tu sais », m’a-t-il souvent rappelé. Quiconque discutait avec lui se sentait considéré au plus haut de lui-même. Un jour qu’il me parlait de la Shoah, il m’a dit : « Il faut chercher à comprendre tout le monde, même les nazis ».
Il avait terminé le manuscrit de son cinquième livre, Trésor, et il commençait un travail sur le génocide du Rwanda, quand il a soudain disparu. Emporté, en deux heures, le vendredi 9 mars 2001 après-midi, par un infarctus massif.
Pour tous ceux qui l’aimaient : la fin du monde.
J’ai grandi sous ses ailes, je suis entrée dans ses pas, je l’ai suivi comme une ombre, je me suis tenue tout près, encore plus près qu’il ne s’en doutait, j’ai écouté, observé, j’ai gardé tout ce que je pouvais. J’avais trouvé, avec lui, quelqu’un qui partageait et faisait vivre devant moi mon idéal : l’écriture et le combat.
Je l’ai vu écrire. Il m’a laissé des principes simples qui ne me quittent jamais : « Tu auras revu ton texte cent fois avant qu’il soit terminé à tes yeux. Quand tu relis, tu coupes, tu coupes, tout ce qui est en trop, impitoyablement. Si une expression n’est pas parfaitement claire, tu la reprends. En cherchant une meilleure forme, tu peux tomber sur un nœud, et de devoir le démêler peut te conduire à tout recommencer. Et c’est comme ça que tu auras appris quelque chose. Ensuite, lisser, lisser le texte, comme un sculpteur polit une statue. Et si c’est difficile, et que la nuit, tu ne dors plus, quand un texte résiste ? C’est la moindre des choses. »
Je lui ai un jour demandé : « Sinon, toi, qui constate tant d’injustice et de malheurs, que fais-tu pour améliorer le monde, à part écrire des livres ? » Réponse après réflexion : « De toutes façons, quand il y a vérité, il y a effet ».
IUFM et associations
Après avoir échoué deux fois au CAPES de philo, je me suis tournée vers le CRPE – Concours de Recrutement des Professeurs des Ecoles. Je l’ai passé pour avoir une idée de l’examen, en vue de m’y consacrer l’année suivante. Surprise, j’ai été admissible. J’ai préparé l’admission en catastrophe, en deux semaines, et j’ai été admise, en grande partie grâce au grand oral, au cours duquel j’ai pourtant annoncé au jury que je transformais la question du sujet parce qu’elle me paraissait mal posée ; j’ai parlé librement, je me suis même un peu fâchée pour répondre à une question légèrement provocatrice de l’examinatrice – qui m’a adressé un grand sourire quand je me suis levée. Je pensais avoir tout fait capoter. Ils m’ont attribué 18. Coefficient 5.
Je suis entrée à l’IUFM -Institut Universitaire de Formation des Maîtres - en septembre 1999. Un drôle de monde à mes yeux. Des discours dogmatiques. Des démarches d’apprentissages figées. Un grand accent mis sur la forme, très peu de contenu. Une méfiance féroce à l’égard toute pratique ou pensée qui avait plus de dix ans d’âge. Une surveillance menaçante des propos des stagiaires. Ces derniers, mal à l’aise. Une grande tension. A mes yeux un scandale, pour un lieu de formation d’enseignants. D’autant plus qu’il n’était pas connu à l’extérieur.
Souvent, après les cours, j’avais de longues discussions avec Christian Geffray. C’est lui qui m’a suggéré de tenir un journal. J’ai alors pris des notes précises pendant les cours, interrogé les formateurs pour les encourager à développer leur discours, et je notais mes remarques le soir dans un cahier.
J’avais pris contact pendant l’été précédent avec l’association Reconstruire l’Ecole. Elle était constituée de professeurs du secondaire qui constataient que s’opérait, dans les programmes, les directives, les manuels, la formation des enseignants, dans toute l’institution scolaire, depuis quelques années, un recul inquiétant des contenus de savoirs, accompagné d’une tension idéologique et dogmatique sur les méthodes et les discours. Ils s’efforçaient d’y résister en continuant d’enseigner d’une part, et en proposant d’autre part des textes d’analyse de la situation, des réflexions, des propositions, selon le principe : « Rendre la parole sur l’école à ceux qui la font ».
Instit : enseigner, observer, témoigner
Quand j’ai commencé dans le métier, je me suis dit que non seulement je devenais instit, mais que j’entrais aussi, pour y participer, dans la grande histoire de l’école républicaine, qui commence avec la Révolution et les Mémoires sur l’Instruction Publique de Condorcet, dans l’héritage des Lumières et des textes de Rousseau, dont la pensée se poursuit avec les textes de Ferdinand Buisson, les lois Ferry sur l’école publique, et continue avec des auteurs comme Alain, Muglioni, Milner…
L’école est pour moi l’élément le plus important de la société. Toutes les institutions sont importantes, tous les domaines professionnels, mais avant tout : l’école. Elle détermine le reste. Dans la vie des individus, dans la vie d’un pays entier. C’est d’elle que dépend que les citoyens détiennent les connaissances qui leur permettront de mener une vie libre, choisir un métier, décrypter les événements, s’exprimer avec aisance, résister s’il le faut.
L’histoire prouve que l’Ecole publique, ça ne va pas de soi ; instituée de haute lutte, elle est ensuite continument menacée par des logiques qui lui sont contraires, hors et dans l’institution elle-même… De fait, l’école ne tient, depuis ses débuts, que par la combativité de ses membres. Comme la démocratie dans son ensemble, elle aussi obtenue de haute lutte et à garder avec vigilance. Les libertés ne se maintiennent pas toute seule. Il appartient aux citoyens qui le peuvent et le veulent de veiller. De guetter les signes du danger. De se battre si besoin. On ne choisit pas. Une fois qu’on a connu l’alerte une fois, le radar est en place. L’alarme sonne avant qu’on ne comprenne, sous la forme d’un malaise sourd.
Mon premier poste a été un CP. Ce niveau tombait bien pour moi. J’y retrouvai une réflexion qui me rappelait la philo : pour trouver les chemins pour conduire les enfants à apprendre à lire, il fallait chercher dans les détails, découvrir des mondes infinis dans de l’apparent pas grand-chose, rechercher pourquoi ce qui semble évident ne l’est pas…
J’ai poursuivi le travail de réflexion avec Reconstruire l’Ecole, puis avec Sauver les Lettres, et plus tard avec le GRIP (Groupe de Réflexion Interdisciplinaire sur les Programmes). Les heures de discussions avec les collègues de ces associations, lors de réunions ou de séances de travail, m’ont appris énormément sur l’histoire de l’école et sur les conditions actuelles, m’ont permis d’avoir des nombreuses références de textes divers, de manuels variés de qualité, et m’ont aidée à élaborer peu à peu mon enseignement.
C’était l’époque des grandes manifestations contre Allègre, qui avait réussi à mettre bon nombre d’enseignants, toutes tendances pédagogiques confondues, dans la rue, en adoptant, pour conduire ses réformes, des moyens particulièrement autoritaires et en tenant des propos méprisants à l’égard des enseignants.
C’est en partie de m’être trouvée dans cet environnement associatif militant qui m’a donné l’idée d’opter, dès ma première année, pour une méthode syllabique pour l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. C’est un choix qui peut sembler naturel vu de l’extérieur, d’autant plus aujourd’hui, mais à l’époque, c’était presque comme convoquer le diable et revenir à des temps sauvages. Il fallait alors enseigner par la méthode mixte. C’était la seule dont il était question dans les textes officiels et les manuels disponibles n’en proposaient pas d’autres. J’ai acheté sur mes frais une ancienne méthode syllabique - la méthode Boscher -, que je cachais lors que j’étais visitée par des formateurs.
En 2002, encouragée par des amis enseignants, j’ai entrepris, en collaboration avec Françoise Samson, éditrice chez Ramsay, de mettre en forme mon journal et mes notes de cours d’IUFM, qui a donné Journal d’une Institutrice Clandestine, sorti en 2003.
Ce qui me motivait par-dessus tout à publier ce livre, c’est que j’avais détesté la tension idéologique que j’avais connue à l’IUFM, et que j’avais été désolée de voir certains collègues ployer sous cette tension. Je me disais qu’il fallait simplement que cette réalité soit connue. Pour que les choses soient portées à l’extérieur et, éventuellement, débattues.
Les années 2000 étaient riches en réformes, en mouvements de protestation, en débats sur l’école. Le livre a trouvé sa place dans ces débats, il a été largement relayé dans divers médias. Il a connu un certain succès, puisqu’il s’est vendu dès la première année à 10 000 exemplaires et a continué par la suite, dans son format de poche, pour atteindre, dans les années suivantes, environ 40 000 exemplaires (1).
Des enseignants m’ont dit être soulagés, que leur pensée soit enfin exprimée. Des parents et des professeurs du secondaire m’ont remerciée de mettre au jour l’inquiétante indigence de la formation des enseignants primaires. Le livre a aussi provoqué des réactions très hostiles chez quelques enseignants et parfois une irritation du côté de certains cadres de l’Education Nationale.
Beaucoup d’autres livres ont paru dans ces années-là, dans une optique similaire au mien : exprimer une inquiétude sur l’avenir de l’école et réfléchir à comment maintenir un enseignement de qualité à la portée de tous. Tous ces livres ont compté. Tout ne va pas parfaitement bien aujourd’hui, mais le discours s’est un peu allégé de son poids idéologique.
Au bout d’un an, Françoise Samson m’a proposé de signer un deuxième livre, qui est sorti en 2005 : Pourquoi et comment j’enseigne le b a ba. Dans ce texte, émaillé d’interventions d’instits chevronnés, je m’efforçais de décrire de quelle façon je concevais le travail en classe. Il a connu moins de succès que le premier, a suscité des réactions furieuses chez certains enseignants primaires, pendant qu’il trouvait chez d’autres, et chez des parents d’élèves, une approbation chaleureuse.
Sur les deux livres, dans certains forums, les propos outranciers allaient bon train : « réac », « fasciste », « nazi »… Ces propos démesurés ont disparu aujourd’hui. Les enseignants qui les ont tenus ont peut-être eu le temps de réaliser qu’enseigner en banlieue dans une école publique avec le souci de faire réussir tous les élèves, ce n’est pas ce qui correspond le mieux à la définition de « fasciste »…
(1) La maison mère des éditions Ramsay s’étant retrouvée en redressement judiciaire en 2004, je n’ai pu toucher à ce jour que les droits d’auteur des premiers exemplaires vendus – quelques milliers.
Août 2020
On peut noter ces derniers temps quelques améliorations, dans le fonctionnement de l’école, comme des changements intéressants dans la formation initiale et, plus récemment encore, la prise de conscience de la difficulté scolaire et la recherche de solutions ; mais on ne peut pas dire que l’école aille tout à fait bien. Les charges administratives croissent pour les enseignants, les programmes laissent à désirer – entre autres par la prose lourde et complexe dans laquelle ils sont rédigés–, les évaluations nationales s’allongent et se multiplient, l’enseignement en primaire se déroule encore dans des conditions matérielles difficiles, pendant que de grandes pressions pèsent sur les enseignants ; par ailleurs, les bons résultats se font attendre, les postes manquent et les candidats au concours se font de plus en plus rares…
Durant ces quinze dernières années, j’ai continué à enseigner, appliquant des méthodes que je me forgeais petit à petit, par expérience, observation, lectures, discussions avec des amis et des collègues. A partir de 2008, j’ai recommencé, parfois de façon irrégulière, à tenir un journal, à raconter des moments de classes et à noter des réflexions. J’écrivais au gré des sujets qui se présentaient au jour le jour – à la faveur d’une question, d’un moment de classe, d’une discussion…
Pour tout dire, je passe mon temps à prendre des notes mentalement, en me promettant : "Il faudra écrire ça un jour". Souvent, en entendant quelqu’un raconter un épisode de sa vie, je pense : "Tout ce que tu me racontes, c'est si beau, il faudrait le mettre en texte un jour". C’est comme si je me disais : « Tout doit être écrit, un jour où l’autre ». Tout ce qui est beau, parce que c’est beau. Tout ce qui n’est pas beau, parce que tout devient beau quand c’est bien écrit. Tout ce qu’on n’a pas pu dire, pour une raison ou une autre, faute de temps, faute de pouvoir être entendu. Tout ce qui inquiète. Tout ce qu’on ne comprend pas bien. Comme si rien, à mes yeux, choses, pensées, événements, lieux… n’avait atteint réellement son existence avant d’avoir été écrit.
C’est en 2016 que j’ai souhaité reprendre la plume plus activement, en vue d’un témoignage sur l’école. C’était tout ce qui me semblait à ma portée pour à la fois continuer d’enseigner et apporter ma petite pierre à la préservation d’une école de qualité. Je ne peux pas bouger des montagnes, mais je peux raconter, exposer, réfléchir, dire ce que je fais, ce que je vois, ce que je pense, et soumettre tout cela à la lecture du publique. C’est ainsi que l’aventure du dernier livre a commencé. J’ai travaillé quatre ans, en collaboration avec Françoise Samson, reprenant l’ensemble de mes textes depuis 2008, continuant mes chroniques, triant mon immense matériau, cherchant comment organiser le tout, jusqu’à aboutir à ce troisième texte sur l’école, Bonjour Maitresse !, Journal d’une institutrice d’aujourd’hui, qui sort ce 27 août 2020.
|
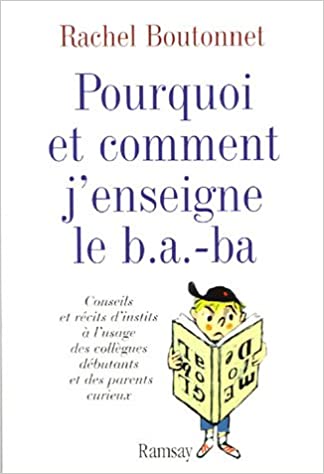
Diponible sur amazon.fr ou dans votre librairie.
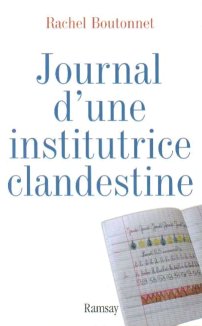
Diponible sur amazon.fr ou dans votre librairie.
|